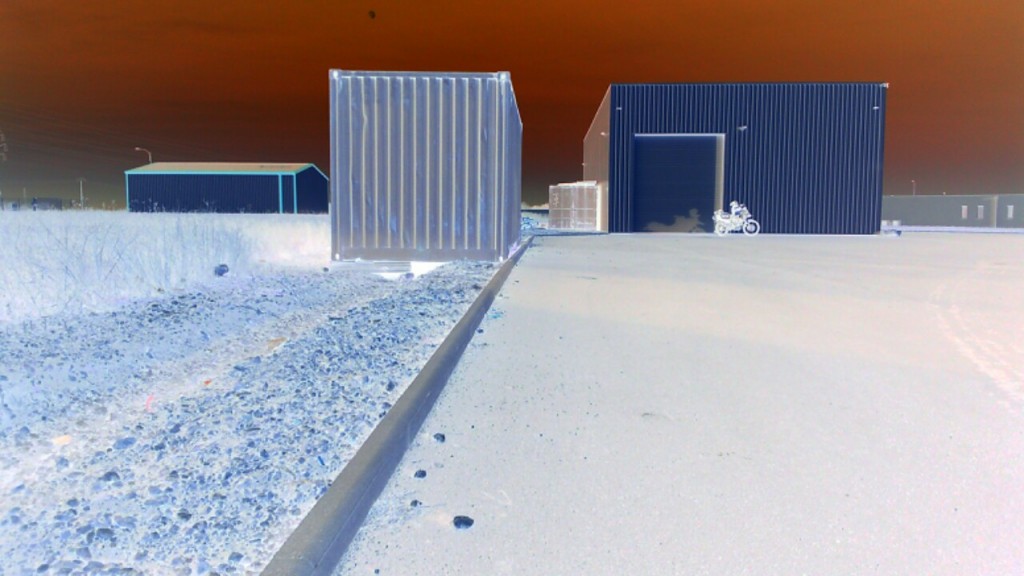Vases communicants Mécano
mars 07, 2014
Je suis très heureuse d’accueillir pour des vases communicants triangulaires ces deux textes de Danielle Masson et François Bonneau. Nous nous étions donnés comme point de départ la mécanique. Les engrenages nous emmènent loin… Pour avoir la complétude de nos échanges, voir mon texte et celui de François chez Danielle, et un autre texte de Danièle et de votre serviteuse chez François.
Et pour retrouver tous les échanges des vases communicants, une seule adresse : Le rendez-vous des vases! Merci Brigitte Célérier!
Sur la mécanique du coeur
Allez savoir pourquoi mais quand le sujet « mécanique » a surgi sous le clavier de François Bonneau aussitôt le nom de Mathias Malzieu et son roman « La mécanique du cœur » se sont imposés à moi.
Peut-être parce j’avais été visité les différents lieux d’écriture sur le Net de Cécile.
« Il neige sur Édimbourg en ce 16 avril 1874. Un froid de canard paranormal cadenasse la ville. Les vieux spéculent, il pourrait s’agir du jour le plus froid du monde. » (1)
Aujourd’hui, nous sommes encore en hiver mais le ciel est bleu, le printemps est presque là. C’est vrai que je suis en Provence. Je suis une privilégiée.
Je me plongeais dans les textes de Cécile, je les dévorais.
Mais non, « Elle (ne) parlait (pas) très vite. Comme si le silence lui faisait peur… » (2) je savourais ses mots, je me perdais dans ceux de ses élèves lors des ateliers d’écriture qu’elle a animés et mis en ligne.
« L’étincelle dans son regard est intacte, mais elle a comme un faux contact dans le sourire.(3) »
Retour sur la série photos de François Bonneau.
Mot de la vraie mécanique.
Une étincelle, celle de la tête de delco de la Maserati que je cherchais désespérément dans le fatras qui s’étalait sous mes yeux.
Plus de faux contact. J’allais pouvoir tourner la clé et reprendre la route.
Les chemins se croisent, les mots tissent leur toile.
Et tout un coup, en continuant ma visite, j’ai lu « Nous sommes des êtres de langue.»
Et je suis repartie à la poursuite de Milán.
Milán venait juste d’arriver.
Ce premier livre, une découverte.
Jamais là-bas, il n’avait eu de livres ou alors juste des pages arrachées qu’il avait gardées précieusement, jour après jour. Des pages arrachées de nulle part. Il ne voulait pas savoir.
Les autres ne savaient pas que les mots étaient précieux donc que le livre, les livres étaient précieux.
Là, la première chose qu’il vit poser sur la petite table à côté de son lit : un livre. L I V R E, le premier mot dans sa nouvelle langue qu’il gardera, toute sa vie, précieusement au fond de lui.
Il est à lui ce livre ? bien à lui ? Elle lui a dit oui. Elle lui a lu le titre « Corto Maltese.
Il ne savait pas d’où était surgi ce livre et encore moins, il ne savait pas qui était Corto Maltese.
Quand il tendit la main vers le livre, il resta yeux grands ouverts devant ce cadeau sans prix, comme tombé du ciel.
Trois semaines plus tard, il avait commencé à prendre ses marques dans son nouveau pays, son nouveau monde.
Il savait ; plutôt, il avait commencé à découvrir l’histoire de « Corto Maltese ».
Il se réservait ce plaisir-là pour lui, juste avant de s’endormir. Il lui avait demandé de lui lire une page tous les soirs. Il ne comprenait pas tout mais la ribambelle de mots faisait une nouvelle musique toute douce dans sa tête.
Aujourd’hui allait avoir lieu sa première journée de pèche.
J’ai peur, je n’ai pas peur, j’ai peur.
J’ai peur de l’eau, je n’ai pas peur de l’eau, j’ai peur de l’eau.
Je tiens ta main très fort, ta main à toi, mon nouveau grand-père.
Et son nouveau grand-père lui donna le nom de tous les poissons qui étaient sur l’étal de Fanny, sur le Vieux-Port.
Il y avait plein de cageots. Cela puait.
Et il se mit à répéter, en chantonnant : anguille, sardine, merlu, roussette, merlan, alose, tacaud, morue, maquereau, hareng, mostelle, donzelle…
Il en avait la berlue.
Danielle Masson
(1,2 et 3) : extraits de la mécanique du coeur
Vingt-quatre pour deux
C’est une forme anguleuse, mais qui n’a pas vraiment de nom. Ou peut-être qu’un quidam, expert en géométrie, lui en a déjà trouvé un, peut-être un très joli, même, mais complètement à notre insu. Alors cet expert ne serait plus un quidam. Dans le doute, laissons-le là où il se trouve. Certainement nulle part.
C’est une forme, donc, dessinée au marqueur indélébile, sur l’établi d’acier, en bord de chaine de montage. Avec des recoins de partout, et des angles, plus droits que la justice. Sur le tapis roulant central, une voiture en construction passe toutes les cinq minutes. Nous sommes en bout de chaine, nous fixons les sièges, et détestons les gros en cuir, chauffants, qu’il faut attraper sans se briser le dos. Nous fixons aussi diverses garnitures intérieures.
C’est donc une forme sur l’établi, clepsydre emplie de métal : elle contient exactement vingt-quatre écrous, lorsqu’elle est saturée. C’est la réserve, pour deux heures. On pioche dedans toutes les cinq minutes. Et l’on visse. Ou l’on écroute, c’est selon. La pause ? Il est moins trois écrous, allez tapis roulant, avance.
C’est autant une forme qu’une barrière, qu’une pendule, qu’un graffiti ou qu’une rayure, qui se vide et s’emplit, à mesure que passent les autos silencieuses, parfois aussi la nuit, tout autour de la chambre, quand il est temps, enfin, de réaliser là qu’on s’est trompé de rêve.
François Bonneau
Illustration : photo F.Bonneau, issue de la série « de tout, un pneu » : http://irregulier.blogspot.fr/search/label/un%20pneu
| Tags: mécanique | More: vases communicants des autres sur Petite racine
Nous sommes des êtres de langue
janvier 28, 2014
Nous sommes des êtres de langue.
Bien sûr nos bras. Nos bras font ce qu’ils peuvent. Battent l’espace, la mesure du temps qui file. Et nos jambes? Nos jambes nous portent. En coton elles nous portent. Nos mains vissent, sévissent. Nos mains rafistolent, font des trucs. Nos mains cherchent ce qui pourrait les retenir.
Nous sommes des êtres de langue.
Nos organes s’entuyautent et font du gros boulot. Nos organes sont trop occupés à faire qu’au dedans tout découle. On ne peut pas leur en vouloir.
Le coeur bat. Le foie déverse. Nous sommes vivants et ça ne suffit jamais.
Nos ongles sont trop sages. Nos cheveux n’ont jamais porté que des chapeaux et des souvenirs de trop boire.
Nous n’avons pas de crinière, pas de griffe qui lacère, pas de sabots à ferrer sur lesquels galoper et fuir, nous n’avons pas d’autre extrémité que la langue.
Nous sommes des êtres de langue.
Sans la langue nous ne savons que hurler. La langue articule la rancoeur, réinvente la douceur.
Avec nos salives nous mouillons l’espace qui est devant nous. Nous sécrétons des fluides qui sèchent à l’air, en dentelles beaucoup plus solides qu’on ne pourrait le croire. Nous accrochons à rien des nids suspendus dans lesquels dormir en attendant mieux.
| Tags: écriture, langage, trace | More: ni l'un ni l'autre
Sans rapport
janvier 12, 2014
« En Pologne, c’est à dire nulle part » – Ubu roi
C’est dimanche, le Super U est ouvert le dimanche matin, le parking du super U est très plein le dimanche matin.
Et puis tiens, nouveau depuis la dernière fois, une langue de bitume a coulé vers la gauche, contournant tout le magasin vers un parking tout neuf, vide encore. Depuis cet envers du décor qui devient précisément son endroit, un nouvel endroit, coule aussi (suinte) l’eau qui fond d’un tas de glace à poissons déversé ce matin aux espaces de livraison.
Et puis tiens, nouveau aussi, ce magasin, pas encore ouvert : bientôt ici pour vous servir un Super U drive. Et vivement : ce sera encore plus rapide pour désintégrer toute possibilité de rencontre.
Au loin la croix pas encore verte, pas encore allumée, d’une future pharmacie géante (ce sont nos nouvelles églises).
Réminiscence de tous ces centres ville désaffectés, un magasin sur trois, sur deux, aux vitrines occultées de blanc de Meudon, où se décollent indéfiniment des panneaux À VENDRE, en exact écho de ces zones d’activité, comme si le pas encore et le déjà fini se rejoignaient dans la même désertion, la même désolation.
Après le futur Super U drive, bordant un champ de racines à manger, une bande de route noire et brillante sinue sur plusieurs centaines de mètres. Elle est enserrée entre des bordures ciments bien nettes qui s’évasent seulement, de loin en loin, en des places de stationnement minute. Confort, logistique. Mais pour aller vers quoi? Tout est investi, tout est normalisé, mais pour aucun usage. On en vient à penser cela : ce qui est à consommer, c’est le territoire. Que surtout surtout, rien ne reste vague.
Quelques parallélépipèdes, immenses, noirs, ou blancs, sont déjà posés dans le paysage, cognant leurs arêtes dures contre le ciel coton. Un jour, demain, ou bien jamais, ils accueilleront (le terme jure, et ricane, même) un magasin discount, un garage, une agence de quoi, et qu’est-ce que ça changerait de le savoir?
Avec ces cubes oblitérés tout est organisé. S’y ajoutent quelques blocs bétons anti-intrusion, quelques excavations, et des barrières métalliques coulissantes formant enclos sur du vide. Aucune forme de vie non autorisée, aucun camp ici ne viendra, ne pourra s’installer – tout est barré.
Une question brûle dans tout cela d’étalé et de morne : y a t-il place encore pour le furtif ?
On passe un bosquet d’arbustes aux branches nues et rouges, poussant depuis un sol recouvert de plastique noir, car c’est plus propre. On foule des terrains retournés, faisant affleurer une argile un peu bilieuse. On s’enfonce, dans ce qui reste de marge. On cherche à éprouver d’autres étalons de la distance que ceux mesurant la proximité en minutes de voiture.
La terre se couvre d’herbes mauvaises, cuites par le gel, avachies comme par trop de fatigue. Les couleurs aussi rampent, tout est rabattu vers le terne. Au dessus de tout cela de tenace et ras qui tient le sol, quelques grands chardons secs, des tiges érigées vers des souvenirs d’ombelles.
Le sol devient crayeux, et au fur et à mesure qu’on avance, sans vraiment s’éloigner, on voit bien qu’on se trompe, des couleurs il y en a, et pas seulement le rouge des rares enseignes pour plus tard. Il y a, courant au sol, le vert acide et vif des mousses et des lichens, et parfois des filets violets comme des veines de malade. Il y a au ciel le turquoise des verres isolant les lignes à haute tension (sous les fils ça crépite). Il y a l’étiquette rose d’une bouteille de Muscadet « Saveur 2013″, et le bleu de cotillons d’un reste d’emballage de Kim Cône.
Et puis, il y a cela qui n’est pas une couleur, la blancheur médicamenteuse d’un test de grossesse.
Comment est-ce possible, dans ce monde où rien ne se touche ?
| Tags: civilisation, déplacements, réel, sexe, trace, vie | More: ni l'un ni l'autre
Avec les yeux
décembre 22, 2013
J’ai le grand bonheur d’avoir été invitée, avec Anne Savelli, Joachim Séné et Pierre Ménard (joie de travailler avec eux!) à conduire des ateliers d’écriture au Louvre. Ce texte est la mise au net des réflexions ayant guidé la première séance de mes ateliers, le 18 décembre. Pour avoir plus d’informations sur ce cycle d’ateliers, suivez ce lien, et celui-ci pour lire un texte de Pierre Ménard sur ses ateliers et le site que nous allons construire progressivement avec ces travaux. Merci à Patrick Souchon et au Louvre pour cette aventure qui commence, et à Joël Paubel pour son accompagnement précieux dans cette première séance.
__________________________________________________________________________________
Au musée on touche seulement avec les yeux. C’est ce qu’on dit, comme dans les pâtisseries. Cette expression m’interpelle, à cause de cet adverbe, seulement, qui classe le regard comme une autre manière de toucher, une moindre manière de toucher.
Je pense à cette expression de « regard tactile ». À cette expérience que nous avons tous fait, de regarder quelqu’un de dos, et qu’il se retourne, comme si réellement il avait senti quelque chose. Nous nous sommes tous retournés aussi, sous la pression d’un regard posé sur nous.
Le regard tactile, c’est le nom d’un livre de Guiseppe Penone. C’est très parlant que ce soit un sculpteur qui ait éprouvé le besoin d’employer cette expression. Le regard non seulement touche mais il transforme, modèle la matière même de ce qu’il fait apparaître.

Guiseppe Penone a réalisé cette oeuvre, Il continuera sa croissance sauf à cet endroit. Il est venu accrocher, au tronc d’un arbre, sa main, plus exactement son truchement, sa main moulée, en bronze. Sa main d’artiste en quelque sorte, celle qui saura tenir longtemps. Ensuite il laisse le temps jouer. L’arbre croit, par sa périphérie. Il croit de partout, sauf à cet endroit de la strangulation, de l’étreinte, que Penone a imposé à l’arbre pour lui donner une autre forme (forme qui n’est jamais que le souvenir, la trace d’un geste de toucher qui, par l’intervention de sa main d’artiste, dure longtemps).
Que nous donne t-il avec cette oeuvre? Il nous met en présence d’un geste. Un geste qui est à la fois de dévouement (il donne quand même sa main!), et de prédation. En tout cas, d’altération. Altérer pour faire apparaître. Sans ce geste qui vient contrarier en partie la croissance de l’arbre, on prendrait l’arbre pour une chose, posée dans le monde, statique. Sauf à le découper on ne verrait pas comme il bouge. On ne verrait que sa forme et non pas son mouvement. On oublierait que la forme de l’arbre, la forme de tout être, est un devenir. Ce geste d’étreindre nous donne aussi à voir, dans le temps, la réciprocité de tout contact. Car la main attrape l’arbre, mais l’arbre, plus longuement, réussira à engloutir la main, si bien qu’à la fin on ne saura plus qui enchâsse l’autre.
(Touchons-nous mutuellement pour nous sentir grandir.)
Et puis cela aussi qui est important : c’est la main de l’artiste qui serre, et pourtant ce n’est pas sa main. Ce qui est à l’oeuvre c’est une sorte d’implication médiatisée, qui est une fiction, non pas dans le sens que ce serait faux, mais dans le sens que c’est un geste pensé, et donc plus intense que ces gestes que nous faisons machinalement pour vivre et nous mouvoir (la fiction, l’art, ce sont les gestes que nous faisons pour nous émouvoir – faire ces mouvements qui nous font devenir).
Tout cela est un détour. Un détour pour revenir au musée, interroger cette injonction qui nous est tacitement faite de toucher seulement avec les yeux. Cette première séance d’atelier j’ai voulu qu’elle ait lieu dans la salle des sculptures dite des caryatides, pour le désir fort qui m’avait pris un jour dans cette salle, à regarder les corps exposés, de les toucher. Toucher, pas s’emparer. Toucher comme caresser. Toucher finalement, très différemment d’en pâtisserie.
Mais qu’est-ce que ça bien vouloir dire, cette idée de toucher des formes, quand la matière n’est pas celle que la forme promet? La chair s’est absentée. Et les marbres qu’on peut admirer au Louvre dans cette salle magnifique ne sont eux-mêmes que les copies, les témoignages d’autres, plus anciens, disparus.
On dirait que cette question me travaille beaucoup, cette question de savoir ce qui se transmet dans le temps et l’espace entre des corps absents, cette question de savoir comment réinventer une présence, pour aujourd’hui, qui sache se jouer de ce qui nous éloigne les uns des autres, en faisant du langage un véhicule qui ne soit pas que d’idées.
(C’est comme si nous avions à nous dé-méduser, nous libérer de ce qui nous pétrifie, en réinventant un regard aimant)

Dans cette salle il y a l’hermaphrodite endormi, à l’ambiguïté composite (dans son corps même, mais aussi dans son apparat – le matelas de marbre, follement moelleux, sur laquelle repose le corps est l’oeuvre du Bernin, quand la statue elle-même est du IIème siècle après JC.)
Il y a surtout, il y avait, car lors de l’atelier d’écriture elle n’y était pas (prêtée sans doute? Toujours est-il que cette absence m’a fait sourire, tellement elle faisait écho à mon projet) une Aphrodite accroupie, manquante en de nombreux endroits d’elle-même. Et au dos de cette Aphrodite, une main. Une petite main d’Eros, vestige d’un contact ancien, toujours actif. Ou alors, manifestation du regard tactile. Le corps d’enfant qui prolongeait cette main n’y est plus. La main elle-même est frappée de fiction : la notice de l’oeuvre indique qu’il n’est pas certain que la statue originelle d’Aphrodite dont cette sculpture est la copie ait été, elle, ainsi accompagnée.

Cette petite main d’Eros, j’en avais fait connaissance avant celle de Penone. Main de prédation, de quémande ou de protection? Elle définit, en tout cas, une zone de sensibilité. Celle qui précisément m’intéresse dans l’acte d’écrire.
Ma proposition d’écriture, ce jour là fut celle-là. Que chacun élise une statue et un endroit précis du corps représenté. Pas plus que la taille d’une paume. Et que chacun la touche avec les yeux, avec toute l’intensité qu’il est possible de mettre dans un geste pensé, un geste d’émotion. Qu’en un mot, chacun vienne poser sa main d’écriture, cette fiction active.
Il est un très ancien genre qui s’attache à écrire le corps par fragment à glorifier, à aimer. Nous avons réinvesti le genre du blason, comme l’a fait aussi Régine Détambel dans son très beau Blasons d’un corps masculin. De ce livre, j’ai lu en séance ce passage « Un jour, il lui dit qu’elle aura beau le regarder, le dévorer, l’inspecter, le toiser, le mirer comme un œuf et lui scruter les lobes d’oreille, lui sonder les orbites, elle ne le possédera jamais tout entier et devra se contenter de ces petits larcins, ces parcelles, ce grappillage mesquin. Elle lui répond qu’elle le regarde pour qu’il continue à penser à elle, qu’il ne disparaisse pas. Elle craint, s’il vieillissait maintenant, si, du jour au lendemain, il n’était plus, de n’avoir pas su garder en mémoire son aura, sa lumière, sa couleur et tout ce qui émane de sa façon de souffler et de porter ses vêtements.
Un autre jour, elle dit : Je te picore comme un tableau qu’on ne peut pas sortir du musée où il est si bien gardé, et dont on veut pourtant se souvenir. »
(Manière de dire, que si c’est bien un regard de détail que je requiers, c’est pour défaire le travail des Erynies comme celui de Méduse, c’est pour recollecter ce qui de nous s’éparpille, par le temps, le mauvais temps – pensée pour les statues amputées, émoussées).
| Tags: civilisation, dialogue, fragilité | More: ni l'un ni l'autre
La folie de vouloir aller quelque part
décembre 19, 2013
Château de Bussy-Rabutin. C’est un petit château d’exil, une réplique, une vengeance miniature contre les pouvoirs en place (pour quoi faire? La même chose, dirait-on, mais peut-être pas tout à fait). C’est un lieu charmant, un domaine, donnant tous les gages de son genre : douves, bassins, chapelle, galerie de portraits, communs.
(Les enfants, ce qui les intéressait : jeter des cailloux dans les douves, les précipiter avec le plus de force possible, constater que rien n’y faisait, la glace était trop prise, les cailloux glissaient sur la surface, inopérants.)
C’est un lieu qui donne tous les gages, et tout y est, mais quelque chose en plus. Une impression de faux, que je ne saurais expliquer autrement qu’en disant qu’il est un mélange de mélancolie (constat de l’échec, n’est pas Versailles qui veut) et d’espièglerie (l’espace de fiction grandit de façon inversement proportionnelle à la superficie des salons d’apparat).
Il faisait froid dans mes bottes en caoutchouc. Même à l’intérieur car ce n’était pas chauffé. Pas éclairé non plus. Alors comment et pourquoi j’ai eu l’oeil attiré par cette sirène maladroite, située tout en bas d’un mur déjà mangé par la pénombre? Comment et pourquoi ce qui doit nous parler vient au devant de nous? Cette sirène je l’ai vu tout de suite, ne l’ai au départ trouvée que plaisante, anecdotique – pittoresque d’être si schématique. Allicit ut perdat, est-il noté. Elle attire pour nous perdre. Bien. Nous voilà prévenus depuis longtemps. Nous voilà prévenus, passons notre chemin. Passons passons, allons au jardin.
Et que nous propose t-on au jardin? Un labyrinthe végétal. Va pour le labyrinthe végétal, les enfants sont ravis. Ils s’engouffrent. Je suis, d’un peu plus loin. J’avance. Je passe par des coudes. Je longe des parois. Au bout de très peu de temps je trouve ça fastidieux. J’attends la bifurcation, l’heure du choix. Ça ne vient pas. Je marche je marche, je tourne à droite, à gauche, je me fais balader. Mais rien ne se passe. Il faut juste marcher, marcher. Au bout de quelques minutes, une éternité, je tombe sur… rien. Je tombe sur la fin. Une impasse. Au bout du chemin le voilà le secret, la révélation, au bout du chemin on tombe sur ce qui nous bordait depuis le début. Sur ce qui nous cernait. Et cette idée qu’on marcherait pareil dans nos vies, avec la même folie morne d’aller sans découragement jusqu’à rien. Que tout parcours serait une erreur, qu’il faudrait rebrousser. Que ce qui nous est demandé c’est cela, passer notre chemin. J’ai obtempéré, j’ai rebroussé. J’avais tellement de rage. Ou plutôt : ce sentiment qu’on appelle l’oppression.
Je suis sortie, je les ai attendu. Mais ils ne revenaient pas. Et je les entendais rire, s’effrayer! Mais de quoi? Et qu’avais-je loupé? Et pourquoi mettaient ils tant de temps à parcourir leur vie quand j’avais grillé la mienne en cinq minutes? Avais-je loupé des allées? J’avais la certitude pourtant qu’il n’y en avait pas d’autres. Et celle plus atroce que si des embranchements avaient été proposés, plutôt que ce sens unique, cela aurait été la même chose. Toujours et seulement la nécessité d’aller à droite ou bien à gauche, de s’engouffrer dans une procédure et de s’y tenir. Toujours la religion de choisir un moyen pour chaque fin. Le triomphe du pragmatisme : adressons bien nos demandes pour qu’elles soient flouées par le bon spécialiste.
Dans le labyrinthe il n’y a bien qu’une seule allée, enroulée, lovée en elle-même. Une trajectoire en involution, débouchant sur rien. Les enfants le savaient, tout comme moi. Mais ils n’y ont pas vu d’impasse. Ce qu’ils ont vu dans le labyrinthe, c’est la promesse de s’égarer. Le dispositif ne tenait pas la promesse? Qu’importe, ils l’ont tenue à sa place. Avec leurs corps agiles et petits, ils ont su traverser les murs de buis. Organiser des trouées. Se perdre, se retrouver. Se rencontrer, avoir cette surprise. Rire. Oublier qu’il y a un but. Oublier l’idée même d’en sortir. Et faire durer le plaisir.
« Elle attire pour perdre ». Grâces soient rendues à la sirène de Bussy-Rabutin, car ma pensée est trop pressée et moins souple qu’un corps d’enfant. On a parfois besoin de figures pour défigurer l’impossible.
| More: ni l'un ni l'autre
A titre préventif
novembre 05, 2013
Il faut vous couper un bras. Très vite. C’est nécessaire. Il n’y a pas à réfléchir : pour vous aussi le diagnostic est sans appel. Vous pouvez passer quand vous voulez, sans rendez-vous. N’attendez pas c’est important. Les conséquences, ensuite, si on fait traîner… Les complications… Croyez-moi c’est beaucoup plus sûr d’agir tout de suite. Tout le monde fait ça, maintenant, en préventif. On aurait dû vous le faire avant, je me demande pourquoi on a trainé comme ça. Ou alors c’est vous qui avez refusé? Maintenant il n’y a plus le choix, je vous préviens. On peut même le faire tout de suite si vous voulez, comme ça vous serez débarrassé. Mais je vois que vous hésitez. Vous voulez le garder encore quelques jours. Quelques mois? Vous n’y pensez pas j’espère? Il faut couper très vite, je vous assure. Mais puisqu’on vous dit que c’est pour votre bien… Vous vous sentirez bien mieux après ça. Plus léger. Vous n’aurez plus, par exemple, de ces balancements qu’engendrent la marche à deux bras, et qui créent ce roulis de l’âme. Vous n’aurez plus cette crainte, de ne pas savoir avec quelle main tenir la raquette.
Mais non ça ne fera pas mal. La technique est éprouvée. Depuis le temps. On arrache et puis c’est tout. Vous vous souvenez de vos dents de lait? Celle qui ne voulait pas tomber, qu’on attachait à une ficelle. On attache la ficelle à une poignée de porte, on claque la porte, la dent tombe : c’est pas plus sorcier. Juste une question de cautérisation, ensuite. Mais on sait faire, n’ayez crainte. Une anesthésie? Mais c’est totalement inutile, enfin.
Sincèrement je vous parle d’expérience, votre vie va s’en trouver considérablement améliorée. Votre santé. Et vous verrez qu’on se passe très bien des chaussures à lacets. Pour le reste, tout est exactement comme avant. En plus simple. Finis les pulls à deux manches, si désespérément symétriques, à ne pas savoir distinguer devant-derrière. Finies les mains sous la table. Qu’auriez-vous à regretter? Ce qu’on vous enlève c’est le bras qui ne sert à rien. Si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous admettrez que vous n’aviez même pas conscience qu’il était là, avant qu’on vous dise que vous ne pouvez pas vivre avec. Vous doutez encore? Mais deux bras, quand même ! À notre époque! Franchement c’est trop! Quelle dépense d’énergie! Tout ça de muscles superfétatoires qu’il faut nourrir et mouvoir… Tout ça d’os inefficaces à porter constamment…. Tout ça de sang à faire circuler… Et puis songez au ridicule. Vous dans la rue avec encore vos deux bras. Tellement… Inadapté. Vous dans la rue avec votre bras qui dépasse. Au vu et au su de tous. Allez vous voyez bien que ce n’est pas pensable….
Je vous sens très agité… Bien, je pense que le mieux maintenant c’est que vous rentriez chez vous. C’est ça : rentrez chez vous, et repassez demain : ça peut bien attendre encore quelques heures.
| More: singeries
L’effacement
octobre 28, 2013
Elle est lourde pour toi. Elle est déjà lourde – ce n’est plus un nourrisson. Ou bien : elle est encore lourde – tu n’es pas si grande.
Elle est ronde. Elle est une balle ronde, jetée dans la mêlée de la famille, c’est toi qui l’a rattrapée.
C’est ton trophée du moment, ton fardeau empesé. Tu es son socle. Le candélabre de la flamme. Pour éclairer quoi devant nous?
Tu fais la petite maman. Tu portes ta plus lourde poupée, celle qui te fais définitivement sortir de l’enfance (c’est moi qui te portais, il n’y a pas si longtemps). C’est moi qui te portais il n’y a pas si longtemps, tu étais déjà lourde, mais pour moi pas encore lourde – je ne suis pas si vieux. Je te portais, mais pas comme ça, pas avec cette façon de femme que tu as déjà, de te servir de tes hanches pour appui, de porter ce que tu portes pour l’exposer, le donner à admirer. Moi je te portais – t’en souviens-tu? – sur les épaules, tes fesses pointues me faisaient un harnais, tes jambes maigres ballotaient des deux côtés de la poitrine, je te portais pour qu’ensemble nous puissions avancer, aller loin. Toi, tu dois poser. Tu dois la faire poser, elle et tous ses atours. Tu as ce geste sûr et gracieux qui produit déjà, ce creusement de la taille, cet effacement, dirais-je, si féminin.
Mais qu’est-ce qui, sur ton visage, te fait ainsi de l’ombre?
______
(ma propre contribution à l’atelier d’écriture du 24 septembre à Peuple et Culture) – voir les 3 textes qui précèdent.
| More: dans le viseur
Après le jeu – Géraldine Heredia
Tu avais été heureuse ce jour là.
Heureuse de jouer cette scène dans le jardin.
Tu avais pu prendre le costume le jour de relâche mais la scène tu l’avais jouée seule, nous laissant combler les silences, nous laissant reconstituer la scène, nous laissant seuls. La fin de cette journée et la fin de l’été s’installaient en moi avec la légère gène à te voir réagir face au silence continuant à jouer comme si ton partenaire n’était visible que par toi. Tes parents avaient ri, je n’arrivais pas à rire. Je pensais à ce que nous avait dit le médecin. Ce n’est qu’après le jeu que j’avais pu prendre la photo, tu avais prévenu, pas de photo pendant que je joue. Je ne sais pourquoi ta mère avait avancé sa chaise, je te voulais en mouvement tu t’étais assise, avais pris la pose.
(Ton visage comme au réveil. Tu ne souris pas, tu as la gravité de celle qui retient un sourire.)
Géraldine Heredia
_________
Géraldine Heredia a participé, avec d’autres personnes, dont vous lirez ici aussi les textes, à un atelier d’écriture que j’ai proposé jeudi 24 octobre à l’invitation de Peuple et Culture, à Marseille. Je n’ai fait que partager ce que je fais moi-même, la même tâche exactement. Mais maintenant c’est leur regard qu’on lit, à la place où j’avais logé le mien en choisissant ces images. Elles échappent à mon regard, c’est tant mieux.
| More: dans le viseur
Une grande fatigue -David Poey
Mon père était malade. Cette réunion de famille lui causait probablement une grande fatigue. Malgré tous les avertissements de sa femme Charlotte, ma mère donc, il avait tenu à se rendre par lui-même au rendez-vous familial de l’été alors qu’il séjournait dans une maison de santé éloignée. Tous les ans nous nous retrouvions en effet dans la vieille propriété, aujourd’hui à mon oncle, dans les Ardennes. Pour certains d’entre nous le voyage était long et éprouvant pour s’y rendre. Il faut dire qu’alors les déplacements n’étaient pas aussi aisés qu’aujourd’hui. Les vieux trains à vapeurs, les automobiles qui vous laissaient le corps en miette après une succession de routes défoncées par la guerre. Pour Pauline, ma jeune fille, c’était comme une aventure renouvelée chaque année, avec au bout la perspective de retrouver ses cousins, ses oncles et tantes… et ses grand-parents. Un conflit sourd faisaient rage entre les générations, seule Pauline, avec son innocence aussi habituelle que calculée, faisait le lien entre la masse de la jeunesse et les lambeaux d’une génération sur le déclin, décimée par des années de privation, de combats et de lutte quotidienne pour la survie. Sa maladie, mon père l’a contracté dans les usines d’armement. Si ses qualités d’ouvrier lui avait épargné le front, elles le placèrent en première ligne face aux saloperies industrielles qu’on regardait alors avec émerveillement comme la promesse d’une paix rapidement retrouvée : l’amiante, le plutonium, l’aluminium et j’en passe… Ma fille avait rapidement su tirer avantage de cette situation. Quand mon père arrivait en boitillant sur la propriété, elle se hâtait de venir l’aider et de l’assister dans ses besoins. Il éprouvait des difficultés à se mouvoir. L’aide de la jolie fillette n’était certes pas adaptée en force mais permettait néanmoins de distraire mon père de son lamento incessant qui faisait fuir tout ses descendants. La France se reconstruisait et avait fière allure mais Père ne faisait que nous rappeler à tous la défaite de 1918. Insupportable à nos yeux. Pauline, elle, se fichait de tout ça et s’appliquait à lui porter à boire, à lui poser des questions sur la nature. Et lui de boire et de se gonfler d’un savoir qu’il n’avait jamais eu.
________
David Poey a participé, avec d’autres personnes, dont vous lirez ici aussi les textes, à un atelier d’écriture que j’ai proposé jeudi 24 octobre à l’invitation de Peuple et Culture, à Marseille. Je n’ai fait que partager ce que je fais moi-même, la même tâche exactement. Mais maintenant c’est leur regard qu’on lit, à la place où j’avais logé le mien en choisissant ces images. Elles échappent à mon regard, c’est tant mieux (ici je n’avais vu que la différence de taille, et le brassard noir sur le géant, ici encore je n’avais vu ma propre peur)
| More: dans le viseur
Tirer des lignes
septembre 15, 2013

De mon bureau j’ai congédié l’hôte. L’ai remplacé, comme support de rêveries dans les interstices que je n’ai pas, par un tableau de bord de ma composition, un paysage de lignes, courbes de niveaux, graphes, et autres imageries, qui ne valent (pour moi) qu’ensemble, que dans leur difficulté à tenir ensemble.
Leur seul point commun c’est de tirer des lignes, et je m’efforce ensuite d’en tirer d’autres entre elles, dans un dessin jamais fixé.
Un tableau de bord(s) dont la lecture et les enseignements se dérobent indéfiniment, malgré la précision de chacune des lignes prises séparément : voici nos vies, la mienne en tout cas.
Alors sans proposer un dessin d’ensemble, tirer quelques traits sur quelques uns des champs dans lesquels, ces derniers temps, je me disperse précisément.
- 25 septembre, performance au Cube, dans le cadre du festival Chercher le texte où un tout petit bout d’Etant donnée sera lu, avec des images de Laure Chapalain
- 3 et 4 octobre à la Fabrique de théâtre pour un APREM# consacré aux résistances numériques
- 11 octobre aux Abattoirs de Toulouse, où j’interviens au colloque Design art et narration à l’heure des expériences interconnectées organisé par le laboratoire Lettres langages et arts de l’Université du Mirail
Tout ça en gros qui tourne autour du projet Étant donnée, après la grande aventure de cet été, dix jours intenses de travail collectif à présenter au public une forme longue de la fiction, sous forme de lecture mise en espace et en images, et sous forme également d’installations plastiques. Et maintenant, nous travaillons sur la version web… Et la nature de ce projet, bien sûr qu’elle est gigogne de ce tableau de bord(s) présenté en images : des traits et points communs entre ses parties, des correspondances, une nature de questions qui se retrouve de champ en champ, et la possibilité, le risque, la chance que rien ne soit jamais clos.
Mais il y a aussi continuer d’écrire sur/avec/contre d’autres traces, d’autres images, avec chaque fois la surprise que ça créé en soi, en sa propre écriture. La surprise de l’écho. Ainsi, à l’invitation de Ciclic, je poursuis une série de textes à partir des films de la base mémoire. Ici le lien vers la rubrique de ma résidence numérique, et le premier texte de cette rentrée. Et de constater, comment mes choix se portent toujours sur de très courts rush, des images en mouvement sous forme de souvenirs qui s’oublient eux-même, à peine des documents, et qu’on n’aura pourtant jamais fini de lire.